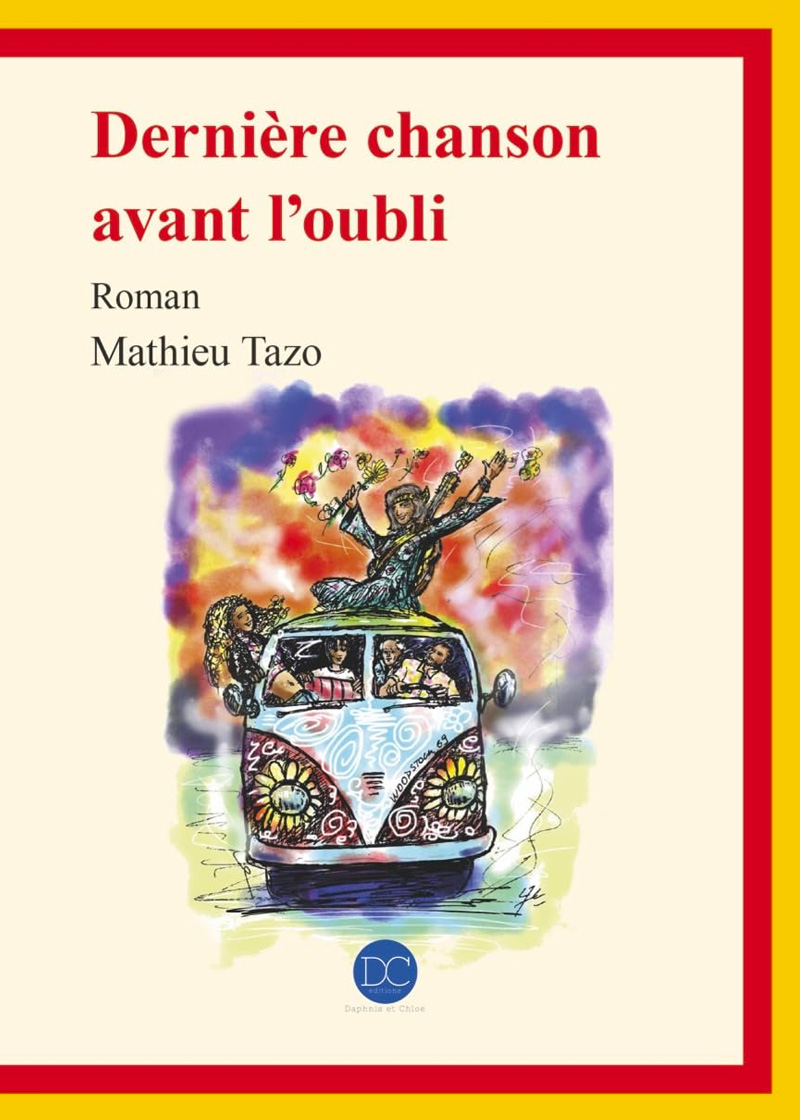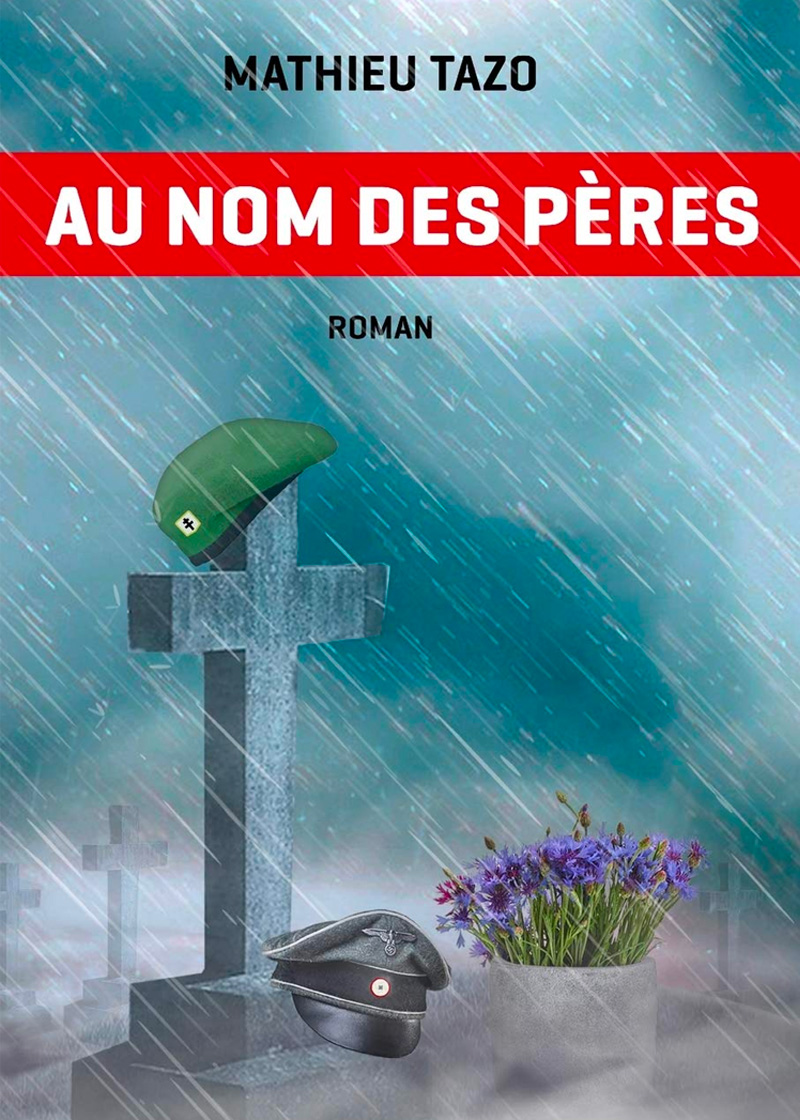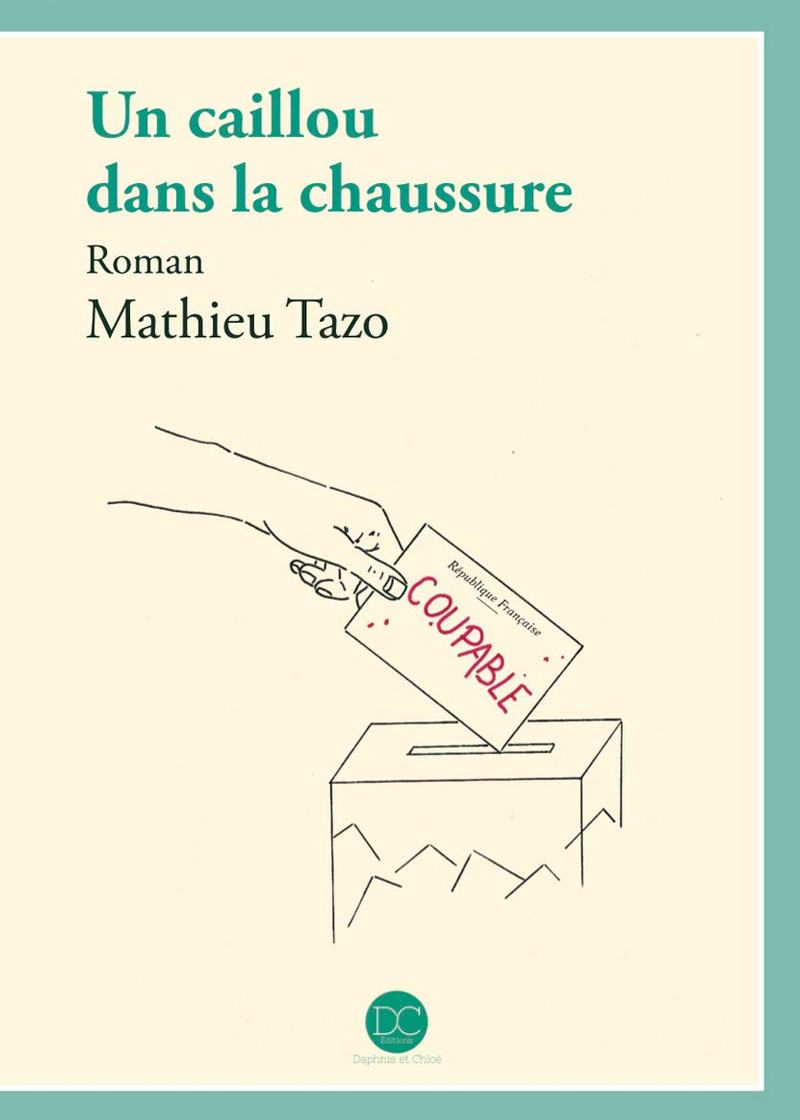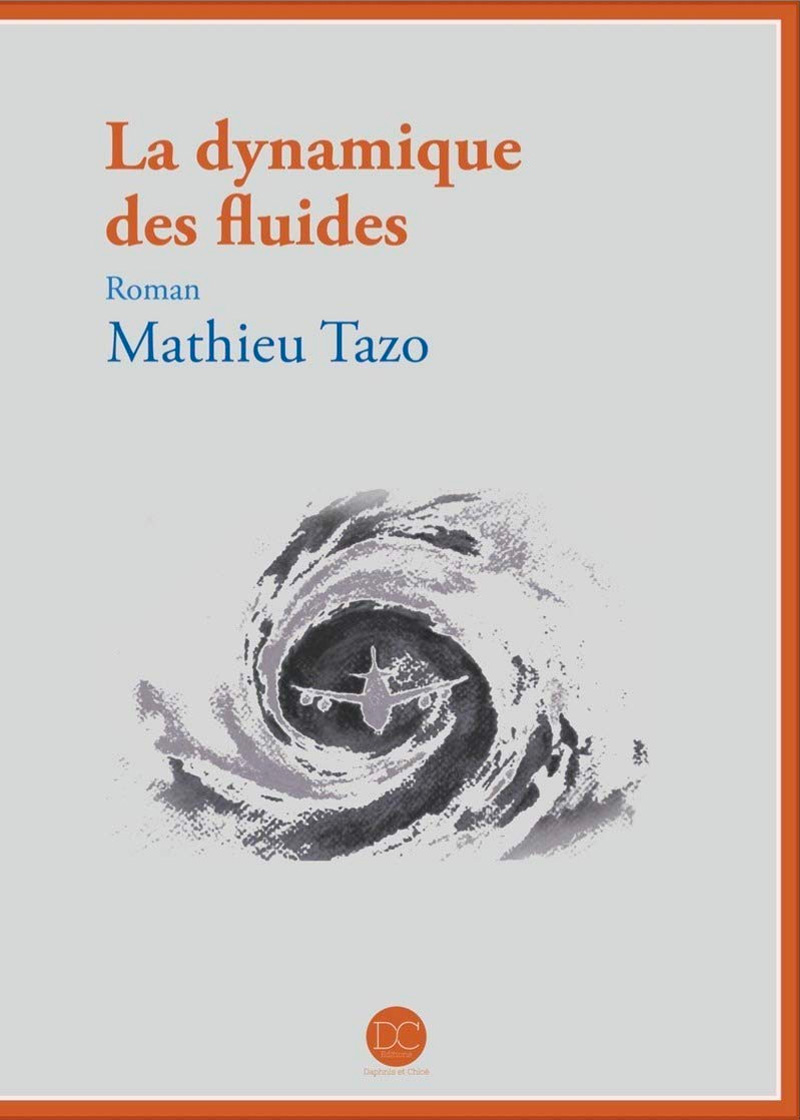L’auteur
Né à Toulon en 1977, mon parcours est la somme de plusieurs expériences très diverses. Mes vingt premières années ont été sportives, en Provence, où j’ai pratiqué le football au plus haut niveau national junior, dans le club de Toulon.
Puis j’ai été diplômé de l’Essec et j’ai commencé ma carrière professionnelle à Paris, carrière qui a ensuite pris une tournure internationale puisque je vis à New York, après avoir vécu à Londres, avec ma femme et mes deux filles.
Je suis venu à l’écriture tout simplement parce que j’aimais inventer des histoires et appréciais lire des romans à intrigues. J’ai donc voulu rédiger mes propres récits et les partager avec des lecteurs.
Écrire occupe aujourd’hui une place importante dans ma semaine, c’est le moment pour moi de quitter le monde en dur pour me plonger dans un monde fictionnel qui prend l’apparence de la réalité mais a le goût de l’imaginaire.
Interview réalisée par le site Parole d’auteurs :
Quel est le premier livre que vous vous souvenez avoir lu ?
Je crains que le premier titre dont je me souvienne soit Ma vie comme un match de Michel Platini… enfant, passionné de football, je n’étais pas un lecteur assidu et il m’a fallu attendre la fin de l’adolescence pour connaître une improbable épiphanie littéraire avec À la recherche du temps perdu (Du côté de chez Swann) que j’ai dévoré malgré moi ; je l’ai tellement apprécié que je n’ai plus jamais osé lire du Proust ensuite, comme si ce plaisir inattendu devait conserver un caractère exceptionnel !
Vous avez eu une jeunesse sportive. Comment passe-t-on de footballeur de niveau national à auteur ?
Il y a un temps pour tout… Le football a été central jusqu’à mes 18 ans ; j’ai eu la chance de connaître le haut niveau en catégorie junior, ce fut exaltant et un bon apprentissage de la performance et de l’effort collectif.
Ensuite, j’ai donné la priorité à mes études et c’est seulement vers 25 ans que j’ai commencé à écrire, d’abord des nouvelles puis des romans. Mon premier roman a été publié presque dix ans plus tard, en 2014. Ce fut exaltant mais différemment. La joie est moins démonstrative dans l’écriture et l’effort plus solitaire !
L’envie d’écrire non assouvie peut-elle être un caillou dans la chaussure de l’auteur en herbe ?
Oui ! Je sentais bien que je marchais sur quelque chose depuis longtemps… mais je ne savais pas comment m’y prendre pour le faire ressortir. Je me suis alors inscrit à un atelier d’écriture à Paris et j’ai commencé à écrire mes premières histoires en parallèle.
J’ai craint de laisser passer une occasion à jamais si je ne m’y mettais pas sérieusement, alors je m’y suis mis ! Et le plaisir est venu de cette liberté de créer des histoires et de les partager.
Pensez-vous qu’il faille être un grand lecteur pour être un bon auteur ?
Je pense en effet que l’écriture se nourrit des lectures et qu’il est difficile d’écrire un roman sans en lire régulièrement. Dans mon cas, je me concentre surtout sur les auteurs qui m’inspirent, soit par leur style, soit par l’histoire qu’ils racontent. Et quand les deux se rejoignent, comme chez Sébastien Japrisot par exemple, je relis chaque roman plusieurs fois !
Comment se sont passés vos premiers contacts avec votre éditeur ?
La maison d’édition Daphnis et Chloé se lançait au moment où j’ai été en contact avec son éditrice pour mon premier roman La dynamique des fluides, et j’ai aimé participer à la naissance de cette maison. C’était l’aventure car elle n’avait encore publié aucun roman au moment où nous avons signé le contrat d’édition. Tout se mettait en place, autour d’une ligne éditoriale et d’une identité visuelle bien à elle. Trois ans après, elle compte une vingtaine de romans publiés, dont les deux miens.
Sort le premier roman, La dynamique des fluides. Accepte-t-on facilement les critiques à ce moment particulier de la vie d’un auteur ?
Publier un roman revient à s’exposer et à soumettre à l’avis de tous un texte qui porte une part de soi et une quantité inavouable d’heures de travail. Et quand il s’agit de son premier roman, la confiance peut vite être ébranlée par les critiques. Je préfère les compliments bien sûr mais j’accepte volontiers les critiques argumentées. Je me souviens notamment avoir fièrement partagé mon premier roman avec mon professeur de français du lycée et lui avoir demandé son avis. Il m’a renvoyé une fiche de lecture détaillée, sans concession, basée sur une rigoureuse analyse de l’histoire et de ses personnages, qui m’a beaucoup aidé au moment de rédiger mon deuxième roman !
La vie d’auteur est une drôle de vie. Avez-vous une anecdote amusante à nous raconter ?
Lors d’une séance de signature pour Un caillou dans la chaussure dans une librairie du Sud de la France, un homme hésitait à venir me voir. Il faisait semblant de regarder d’autres livres, lançant quelques coups d’œil curieux, puis il s’est approché, timide, et on a engagé la conversation. Il m’est rapidement apparu qu’il n’était guère intéressé par mon roman mais avait plutôt besoin de parler de lui, de sa vie (peu banale), de son œuvre (des écrits non publiés), de ses amours (tristes) et de sa santé défaillante. Une heure plus tard, lorsque le monologue s’est tari, une gêne s’est installée : il lui fallait partir, un RDV quelque part et nous n’avions toujours pas parlé de mon roman qu’il tenait entre ses mains. Il cherchait maintenant à s’échapper, pris dans le propre piège de sa bavardise, et s’en est sorti par une superbe pirouette : « Je pars en Bretagne en vacances la semaine prochaine. Si je le trouve là-bas, je vous promets, je le prendrai. » Il a reposé le livre et est parti.
Quel est le dernier livre que vous ayez lu ?
Les racines du ciel. Une œuvre magnifique comme sait les écrire Romain Gary. Un roman écologique avant l’heure où un homme seul se lance dans la protection des éléphants dans l’Afrique colonisée et où l’auteur, au-delà des éléphants, évoque la protection d’une certaine idée de l’homme.
J’ai commencé à lire Romain Gary il y a deux ans seulement et, vu sa bibliographie, je sais que j’ai devant moi de nombreuses années de bonheur littéraire !